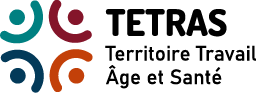TERVILLE
- Sociologie du genre
- Sociologie des médias
- Sociologie de l’édition
- Sociologie des intermédiaires culturel·les
"Femmes puissantes", "icônes féministes", "voix centrales" et autres déclinaisons ...la contribution croisée de l'édition et des médias à la construction d'une notoriété "féministe"
Ce sujet de recherche repose sur le constat d’une démultiplication de termes et d’expressions (femmes puissantes, grandes femmes, femmes inspirantes, et autres déclinaisons) dans l’édition et la presse visant à promouvoir et valoriser certaines personnalités féminines.
Ce foisonnement est concomitant du retour de la mouvance états-unienne #MeToo (importée en France sous la dénomination #BalanceTonPorc). Ce mouvement d’envergure mondiale de dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes et minorités de genre, a conduit à un questionnement de l’ordre patriarcal dominant, des codes et rôles sociaux, et particulièrement des normes de genre.
Parallèlement à ce traitement médiatique d’ampleur, le secteur de l’édition s’engage significativement dans ce mouvement de valorisation de la parole des femmes. On observe ainsi une augmentation de la parution d’ouvrages qui convergent vers la dénonciation des rapports de domination femmes-hommes, à travers les violences sexistes et sexuelles, ou plus largement les inégalités de genres (symboliques, économiques…) [entre 2017 et 2020, la production de livres consacrés aux femmes en non-fiction a augmenté de 15 % . Source : Livres Hebdo]. La valorisation de personnalités féminines par l’édition s’observe notamment à travers des succès littéraires. Certains de ces ouvrages deviennent des long sellers et des best sellers : leur succès commercial s’inscrit dans le temps, et leurs autrices accèdent à la notoriété.
Cette thèse porte sur la contribution croisée de l’édition et des médias à la construction de la notoriété de ces autrices féminines présentées par ces secteurs sous un ensemble de syntagmes à l’instar de « femmes puissantes », « icônes », « voix centrales », ou encore « symboles féministes ».
Cette recherche se situe au croisement de la sociologie des médias, de l’édition et du genre. Il s’agit d’étudier comment s’articule le travail de la presse et des professionnel·les des maisons d’édition (les « intermédiaires culturel·les ») dans la fabrication de la notoriété d’autrices.
Pour ce faire, nous analysons les trajectoires d’autrices d’essais à succès sur les femmes et le genre en les replaçant dans leur contexte à l’instar de Mona Chollet, Ovidie, Pauline Harmange, etc.
Cette étude s’opère en croisant deux méthodes.
D’une part, nous engageons une analyse de discours de presse à partir des bases de données Factiva et Europresse. Nous construisons un corpus d’archives d’articles de presse écrite nationale consacrés à ou mentionnant significativement ces autrices. Ce corpus fait par la suite l’objet d’une analyse de discours, Par cette méthode, nous cherchons à identifier les termes qui leur sont associés, selon les types de presse (orientations politiques, presse spécialisée ou généraliste), les rubriques (littérature, culture, société, « féminisme » ?), les journalistes.
D’autres part, nous effectuons un travail de terrain à travers une trentaines d’entretiens semi-directifs menés auprès de professionnel·les ayant pris part à la conception et/ou promotion des essais. Nous rencontrons des autrices (à l’instar de Mona Chollet, Pauline Harmange, Ovidie), des professionnel·les de l’édition, des agent·es littéraires, et des journalistes de presse écrite. Par l’étude de leurs trajectoires sociales et professionnelles, de l’exercice de leurs métiers respectifs et des liens qu’ils et elles entretiennent, nous analysons les mécanismes de construction de cette notoriété féminine.
Julie Sedel