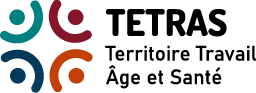TAGES
- Imbrication des rapports sociaux
- Sociologie des classes populaires
- Espaces localisés
- Sociologie politique
- Sociologie rurale
Les compétences psychosociales (CPS) : quand un dispositif de santé publique remodèle les orientations des politiques socio-éducatives territoriales. Une approche ethnographique comparée des régions et des territoires auprès des strates populaires.
Introduites dans la Charte d’Ottawa en 1986 comme un vecteur majeur de la promotion de la santé, les compétences psychosociales (CPS) sont définies par l’OMS (1993, 1997) comme un ensemble d’instruments sociaux, cognitifs et émotionnels permettant aux individus de s’adapter face aux exigences de la vie quotidienne. Depuis lors, elles ont progressivement investi l’agenda politique et font désormais l’objet d’une institutionnalisation croissante à travers des dispositifs visant leur diffusion à grande échelle. L’instruction interministérielle de 2022 en atteste, inscrivant leur généralisation dans une dynamique nationale afin que chaque enfant, jeune et parent puisse les acquérir. Cette dynamique institutionnelle se manifeste également par leur intégration dans le programme d’Éducation morale et civique (EMC) publié au Journal officiel en juin 2024, ainsi que par un développement croissant de structures associatives dédiées au renforcement de ces compétences, en particulier dans le cadre des politiques de soutien à la parentalité.
Les CPS se déclinent en plusieurs catégories d’aptitudes, parmi lesquelles figurent la promotion du type de pensée (critique, créatif), la capacité de résolution des conflits ou encore la prise de décisions constructives. Pourtant, leur déploiement massif dans les sphères éducatives et sociales soulève des interrogations quant à leurs effets (individualisation et psychologisation des inégalités sociales par exemple) sur les orientations des politiques publiques. Ce travail doctoral vise ainsi à examiner la manière dont un dispositif issu, initialement, du champ de la santé publique (re)configure les orientations et les cadres normatifs de ces politiques, autrefois structurés autour d’autres paradigmes.
L’enquête de terrain s’appuiera sur une double entrée. D’une part, elle s’intéressera aux récipiendaires du dispositif – parents et enfants – issus des milieux populaires, appréhendés dans une acceptation plurielle et hétérogène (Hoggart, 1970 ; Renahy et al., 2015). Cette approche s’inscrit dans une perspective territorialisée, prenant en compte des contextes contrastés, allant des espaces ruraux aux zones urbaines, parfois classées prioritaires au titre de la politique de la Ville. D’autre part, elle s’attachera à examiner les pratiques et discours des professionnels chargés de sa mise en œuvre, afin d’appréhender les logiques d’appropriation et de traduction du dispositif dans différents cadres institutionnels.
Ingrid VOLERY et Jessica POTHET